Nù Barreto est un artiste plasticien originaire de la Guinée Bissau. Ce passionné des arts découvre très tôt sa vocation au contact de son frère aîné qui l’initie au dessin. « La bande dessinée fut mon premier amour et mon compagnon de solitude imposé, un moment de communion entre l’art et moi », nous confie-t-il. Il quitte son pays à l’âge de 22 ans et s’installe en France pour étudier la photographie à l’école des Gobelins. Son oncle tente de le dévier de sa trajectoire, les métiers de l’art étant une voie difficile à embrasser. Malgré la relation conflictuelle qu’il entretient avec son oncle, le jeune guinéen s’accroche et réussit à boucler ses études. Après des débuts difficiles dans la photographie, Nù Barreto se tourne tout naturellement vers la peinture. La photographie me semblait assez statique et restreinte car elle n’apporte pas la possibilité d’ajouter des éléments importants pour permettre une lecture fluide et facile d’une œuvre (..) Par contre, la peinture et le dessin me permettent d’agir à ma convenance. L’invitation d’une amie à une exposition sera le point de départ de sa carrière artistique. Connu pour son travail d’artiste engagé, Nù dénonce dans la majorité de ses œuvres des problèmes de société. Aujourd’hui, son travail est exposé à l’international, notamment en France, au Portugal, en Espagne, au Brésil…Sélectionné pour représenter la Guinée Bissau à l’exposition Lumières d’Afriques, nous avons voulu en savoir plus sur l’artiste.
Vous représentez la Guinée-Bissau dans l’Exposition « Lumières d’Afrique » qui réunit les 54 pays Africains au Palais Chaillot à Paris. Qu’avez-vous ressenti à l’annonce de votre sélection ?
C’est tout simplement une joie de partager son expérience et son histoire avec les autres. J’ai eu dans le passé d’autres occasions de représenter la Guinée-Bissau. C’est toujours un moment d’échange fantastique. J’espère simplement la représenter dignement en montrant les préoccupations des guinéens au monde entier.
Le thème de l’exposition c’est l’accès à l’énergie pour tous les pays africains. Pensez-vous que la Guinée-Bissau est concernée par ce problème?
La Guinée Bissau est logée à la même enseigne que le reste du continent. Depuis son indépendance en 1973, le problème d’énergie comme tant d’autres n’a jamais été pris en compte sérieusement. Ce crucial et vital problème a toujours été traité par intermittence, comme si la vie et le développement du pays n’en dépendent pas.
Nous sommes dans une période de légère amélioration qui pour moi est aussi le symbole de la fragilité. Il y a des lustres qu’on nous parle d’un projet de construction d’un barrage hydraulique qui aurait une capacité suffisante pour la sous région…We are still waiting.
Votre dernière série tourne autour de personnages qui flottent dans les airs. Comment vous est venu cette idée ?
Je serai toute ma vie lié amoureusement à ma culture. Je puise en elle mes raisons de décrire et crier mes amertumes. Que ce soit des causes universelles ou pas, j’essaie de puiser les sources nécessaires pour en être compris.
En Guinée-Bissau, lorsque vous n’avez aucun soutien, on dit que vous êtes lâché comme du pollen dans l’air, d’où l’expression en Créole « Largadu suma lã na bentu ».
Par errance, en quête de liberté et de sens, ces personnages tératologiques envahissent mes oeuvres depuis longtemps et m’aident à trouver une solution à mes questions.
Pouvez-vous nous parler de cette couleur grisâtre omniprésente dans cette série ?
La couleur « Pretu Funguli » (Noir Funguli) reflète un désarroi et une situation. Lorsqu’un individu n’utilise pas de lotion pour le corps, sa peau devient blanchâtre et sèche, ce qui donne un aspect grisâtre sur les personnes noires ébène. Ce phénomène qui touche ceux vivant dans une pauvreté extrême est propre à l’Afrique et témoigne d’un flagrant déséquilibre économique et social. Ce sont souvent les enfants qui sont victimes de cette carence. La couleur « Pretu Funguli » a été extraite de ce phénomène puis transposé de manière à décrier le sens du mot « Funguli ». En créole guinéen, ce mot veut dire « avoir la peau blanchâtre ». Aujourd’hui, il est entré dans le langage courant et est utilisé pour séparer les classes sociales. Pour endiguer ce fléau, je dénonce donc cette inégalité avec ma couleur de coeur, le « Pretu Funguli ». Elle fait partie de ma création actuelle et je poursuis ma démarche de manière à trouver une issue favorable. Une issue de compréhension.
Quels sont les peintres africains que vous admirez ou qui vous inspirent ?
Je préfère parler de considération et non d’admiration dans certains cas. Mise à part l’engagement dans la criarde ligne idéologique que je défends. Je pense avoir un travail antagonique et particulier. Le vécu est personnel à chacun, nous avons tous une histoire et un rêve à partager.
Je ne m’inspire pas de personnes. Je compose avec les vécus ou les expériences des autres.
J’apporte une réelle considération pour le travail de Ernesto Shikani (Mozambique), El Anatsui (Ghana), Iba Ndiaye (Sénégal), Ernest Duku (Cote d’Ivoire), Jacob Yacouba (Sénégal) ou encore Manuel Figueira (Cap Vert), Ludovic Fadairo (Bénin), Freddy Tsimba (RDC), Braima Injai (Guinée-Bissau), Soly Cissé (Sénégal)… enfin la liste est longue. La tranquillité de l’expression de Piniang (Sénégal) me passionne énormément ! Certains parmi la longue liste, ont construit une démarche pleine de sens et un travail consistant tandis que d’autres, plus jeunes, font un remarquable travail.
Je ne saurai citer ma préférence tant la liste est vaste.
L’Afrique a des grands artistes.
Avez-vous un thème particulier sur lequel vous travaillez ou envisagez de travailler ?
Je ne me suis jamais imposé une thématique à aborder. J’ai souvent suivi mon instinct et j’avoue que l’humanité me donne assez à faire.
J’ai un travail très engagé qui résulte de ma volonté de défendre des causes.
Je développe encore le Prétu Funguli (Noir Funguli), car j’estime avoir encore tant de choses à produire pour dénoncer. Je laisse libre cours au destin de continuer à m’imposer des causes à défendre.
Le thème de l’identité pourrait être un prochain combat, parce que depuis pas mal de temps, je me pose beaucoup de questions à ce sujet. A voir…
L’oeuvre ci-dessus est notre coup de coeur. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?
Il fallait aborder le thème de la Lumière sous deux angles différents. Premièrement, Lumière comme source et deuxièmement, Lumière comme potentialité ou capacité de s’assumer en tant qu’africain et être humain.
De ce fait, Sukuru qui est le titre de l’oeuvre a subi deux étapes.
En voulant tester et démontrer le résultat du manque de lumière, j’ai abordé l’étape initiale dans la pénombre totale, exprimant parallèlement la difficulté que le manque de lumière nous inflige.
La deuxième lecture consiste à poser ces personnages dans une position de totale capacité de leurs moyens et de montrer une émersion, têtes hautes et sans complaisance vers un nouveau monde. Les personnages ne sont pas à la recherche de considération par compromis ou intérêt mais désirent être considérés à leur juste valeur.
Ces deux approches juxtaposées me semblent indispensable si l’on considère la lumière comme source mais aussi Lumière d’une projection. J’ai ajouté quelques collages de textes pour faciliter la lecture de l’oeuvre et permettre à chacun une libre interprétation.
L’idée de confronter et exprimer les deux sens d’une seule Lumière, semble propice au confrontations des objectifs de développement d’une société.
Donc la lumière reste une source indéniable dont on aura éternellement besoin.
Découvrez les oeuvres de Nù Barreto sur son site internet : www.nubarreto.com
Nù Barreto is a visual artist originated from Guinea Bissau. This man of arts and passion discovered his vocation from his elder brother who taught him how to draw at an early age. « Comic strip was both my first love and my companion in solitude, a moment of connection between arts and I », he says. He moved to France at 22 and studied at the Paris based School of the Image, in Gobelins. His uncle persuaded him to change his orientation as visual arts are not something easy to handle. Despite the conflicting relationship he had with his uncle, the young Guinean persevered and managed to finish his studies. After a tough start in photography, Nù Barreto naturally turned to painting. « Photography sounded quite static and limited because it does not bring the possibility to add elements that allow you to have a clear and easy reading of the artwork (…) By contrast, painting and drawing can offer you the opportunity to act at your convenience ». The invitation to an exhibition from a friend of his will be the starting point of his artistic career. Known for his work of an engaged artist, Nù denounces social issues in most of his paintings. Today, his artwork is exhibited all over the world : France, Portugal, Spain, Brazil… Nominated to represent Guinea Bissau at Lumières d’Afriques Exhibition, Afrique sur scène wanted to know some more about the artist.
You represent Guinea Bissau in « Lumière d’Afrique » Exhibition that gathers the 54 African countries at Chaillot Nationale Theater in Paris. How do you feel with regards to your nomination ?
It is simply a great joy to share my experience and my story with others. In the past, I had other opportunities to represent Guinea Bissau. It is always a fantastic moment of exchange. I hope I will be a dignified representative and will be able to show Guinean concerns to the whole world.
Acces to energy for all African countries is the theme of the exhibition. Do you think Guinea Bissau is concerned by this issue ?
Guinea Bissau is in the same boat as the rest of the continent. Since it recovered its independence in 1973, the energy issue, as well as many other ones, has never been taken into account seriously. This crucial and vital problem has always been addressed in an intermittent manner, as if life and development do not depend on it.
We have entered a period of slight improvement that is, in my eyes, a symbol of fragility. We have been waiting for ages, an hydraulic dam construction project that would have enough capacity for the sub-region…We are still waiting.
Your latest serie is about characters that appear to float in the air. How does this idea come out to you ?
I will be faithfull to my culture all of my life. I draw my inspiration from it to describe and express my resentments. Whether they are universal causes or not, I try to get enough inspiration from it so that to be understood.
In Guinea Bissau, when you have no support, we say that you are released like pollen into the air, hence the Creole expression « Largadu suma lã na bentu ».
Wandering in search of freedom and meaning, those teratotolgy characters have been invading my artworks for a long time and have helped me find a solution to my questions.
Could you tell us more about the « Pretu Funguli », this greyish colour that defines your style for this serie ?
The « Preto Funguli » colour generates both a disarray and a situation. When an individual does not use body lotion for his skin, the latter becomes whitish and rough, providing that greyish aspect especially on dark skinned persons. This phenomenon that affecting people who are living in a severe poverty is specific to Africa and reveals an economic and social stark imbalance. Children are often the victims of this void. The « Pretu Funguli » colour has been extracted from this phenomenon and then transposed so that to denounce the meaning of the word « Funguli ». Guinean Creole defines that word as « having a whitish skin ». Today, it has entered the language and is used to separate social classes. To curb this problem, I am denouncing this inequality with my heart colour, the « Pretu Funguli ». It is part of my current creation and I continue my mission seeking a favourable outcome that ensures a thorough understanding.
Who are the African visual artists that you admire or take inspiration from ?
I prefer talking about consideration and not admiration, in some cases. Aside for the involvment into the pressing ideological line that I have been defending. I think I have an antagonistic and particular work. Lived experience is something personal to eah of us. We all have a story and a dream to share. I do not draw inspiration from anyone. I am coping with the lived experience of others.
I have a real consideration for the work of Ernesto Shikani (Mozambique), El Anatsui (Ghana), Iba Ndiaye (Senegal), Ernest Duku (Ivory Coast), Jacob Yacouba (Senegal) ou encore Manuel Figueira (Cape Verde), Ludovic Fadairo (Benin), Freddy Tsimba (DRC), Braima Injai (Guinea-Bissau), Soly Cissé (Senegal)… the list is endless. The relative calm of Piniang’s expression (Senegal) passionates me a lot. Among this long list some of them have constructed an important path filled with meaning while other youngers have done an impressive work.
It is difficult to choose my favourite one as the list is so long. Africa has got great Artists.
What are you working on now or what are you planning to work on in the future?
I never impose myself a theme to undertake. I often follow my instinct and I must admit that humanity provides me enough to do. I have an engaged work that comes from my willing of defending causes.
I am still developing « Prétu Funguli » (Black Funguli) because I think I still have a lot to produce if I wish to to denounce things. I hope destiny will keep on imposing me causes to defend.
The identity theme could be my next struggle because I find myself continually questioning about it. We will see…
Your above artwork is our crush. Can you highlight us about it ?
I have to undertake the Light theme under two angles. First, Light as a source and second Light as a potential or an ability to assume oneself as an African or a human being.
As a result, Sukuru which is the artwork’s title has required a two step process.
While wanting to test and proving the result from the lack of light, I started the first step by working on the shadows, expressing at the same time the difficulty that situation could cause.
The second step consisted in having those characters in full possession of their faculties and showing an emersion, head-up without fear or favour towards a new world. The characters are not looking for compromise. They just want to be considered at their fair value.
A side-by-side comparison sounds essential if we consider Light as a source and also Light as a projection. I added some collages of newspapers so that to have an easy reading of the artwork and allow people to have their own interpretation.
The idea of confronting and express the two meanings of one Light sounds favourable to a society’s development goals.
Thus, Light remains a key source that will be needed forever.
Discover Nu Barreto’s artwork on his website : www.nubarreto.com


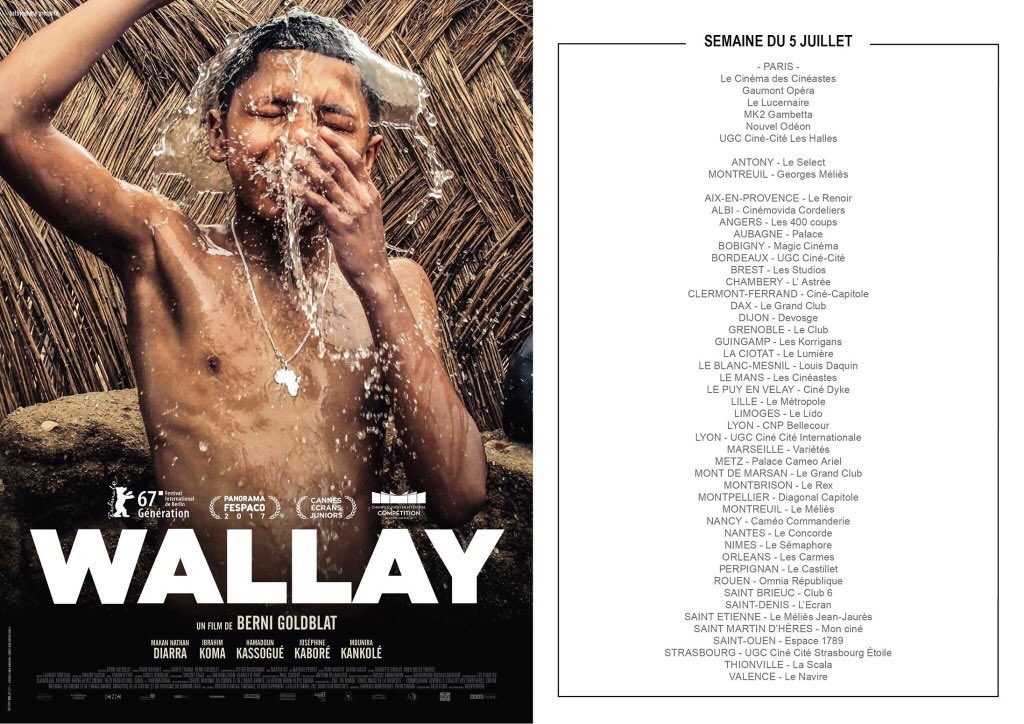


 Le scénario est écrit en français puis traduit et adapté en lingala. Conscient des complexités liées à la traduction, Alain Gomis et ses collaborateurs décident de composer avec. « Certaines choses », comme il le souligne, « sont intraduisibles dans une langue…Il faut accepter de perdre ». Il sait surtout que la compréhension d’une culture passe par la langue d’où le choix du lingala comme langue principale du film.
Le scénario est écrit en français puis traduit et adapté en lingala. Conscient des complexités liées à la traduction, Alain Gomis et ses collaborateurs décident de composer avec. « Certaines choses », comme il le souligne, « sont intraduisibles dans une langue…Il faut accepter de perdre ». Il sait surtout que la compréhension d’une culture passe par la langue d’où le choix du lingala comme langue principale du film. En dépit de son manque d’expérience, Alain Gomis lui fait confiance. Il lui laisse l’espace nécessaire pour s’exprimer librement. « Moi, je ne dis pas grand chose du personnage à un comédien, j’essaie de rester très concret sur la situation ». Le résultat ne se fait pas attendre. L’actrice trouve naturellement sa place dans un environnement qui lui est familier et en même temps, remet en question tous les à priori sur le manque de jeu des acteurs africains. En effet, la maîtrise parfaite de la langue, de son corps et de l’espace lui permet de comprendre le personnage de Félicité et donc d’intégrer aisément son histoire.
En dépit de son manque d’expérience, Alain Gomis lui fait confiance. Il lui laisse l’espace nécessaire pour s’exprimer librement. « Moi, je ne dis pas grand chose du personnage à un comédien, j’essaie de rester très concret sur la situation ». Le résultat ne se fait pas attendre. L’actrice trouve naturellement sa place dans un environnement qui lui est familier et en même temps, remet en question tous les à priori sur le manque de jeu des acteurs africains. En effet, la maîtrise parfaite de la langue, de son corps et de l’espace lui permet de comprendre le personnage de Félicité et donc d’intégrer aisément son histoire.






